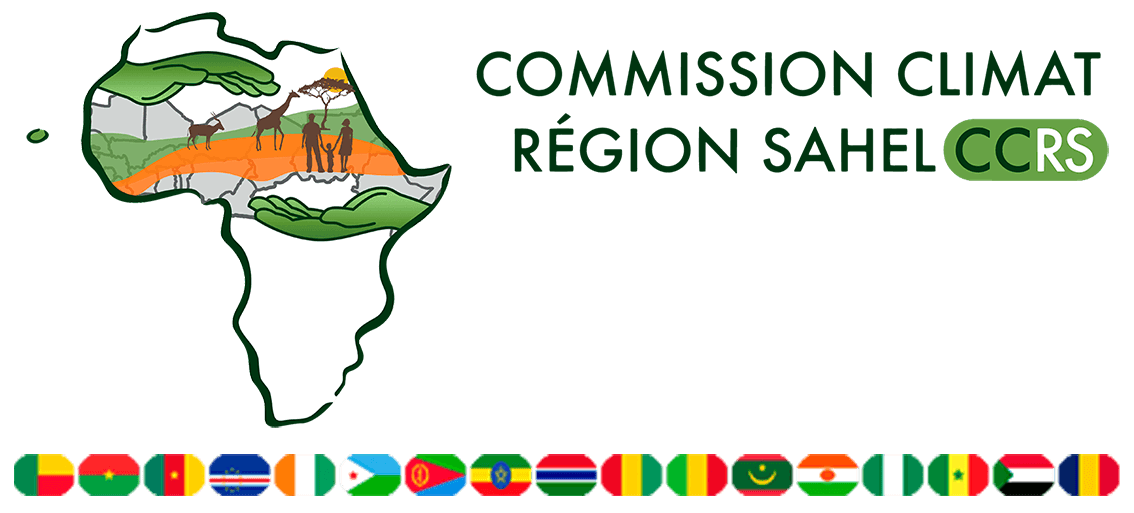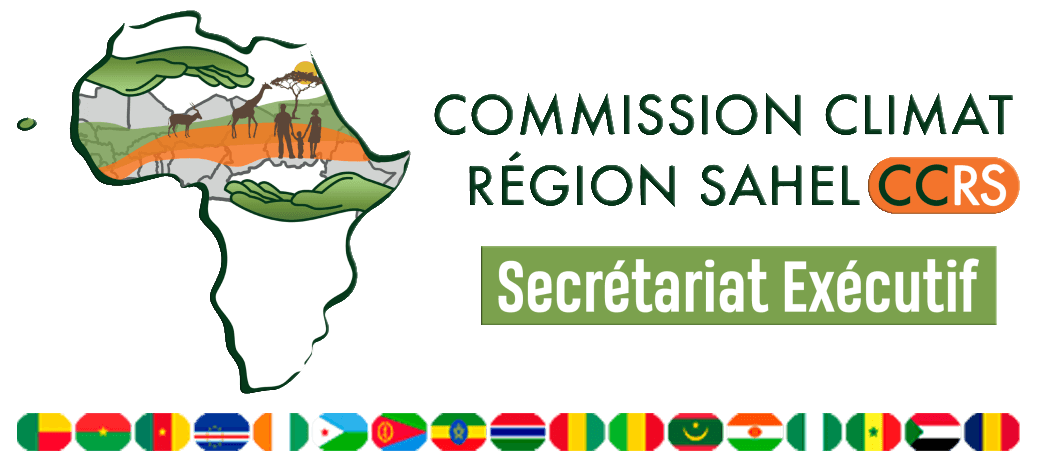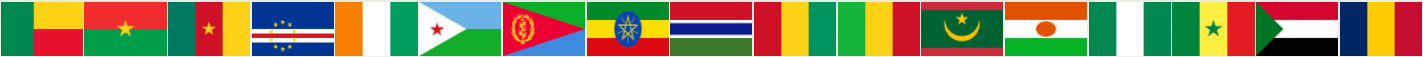Le Secrétaire Exécutif de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS), SEM. Issifi Boureima a pris part ce lundi 09 Septembre 2024 à la cérémonie d’ouverture de la 3ème Conférence Scientifique Internationale sur le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest et au Sahel (CICC2024).
Cette rencontre de trois jours qui réunit des experts et des chercheurs de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, vise à identifier et à promouvoir des stratégies efficaces pour renforcer la résilience des secteurs socio-économiques face aux changements climatiques notamment le partage de connaissances, l’analyse des impacts et la proposition d’orientations stratégiques claires pour l’avenir
La CCRS étant une partie prenante importante du processus ayant conduit à la création de cet événement scientifique périodique, l’occasion a été donnée à son Secrétaire Exécutif de prononcer une allocution dans laquelle il a passé en revue les défis et enjeux des problématiques en lien aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
Il a en effet relevé la pertinence du thème de l’édition 2024 : « Évènements climatiques extrêmes et Risques de Catastrophes en Afrique de l’Ouest et au Sahel » qui se tient dans un contexte aussi bien préoccupant que grave au regard de la tournure dramatique engendrée par les pics de chaleur enregistrés cette année au Sahel ainsi que les fortes précipitations qui s’y abattent ces dernières semaines au Niger comme dans le reste de la région.
SEM. Issifi Boureima a par ailleurs rappelé que la CCRS, à travers le Plan d’Investissement Climat pour la Région du Sahel (PIC-RS) promeut la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités institutionnelles et techniques notamment, des institutions de recherches & développement, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. Ce volet du PIC-RS prend ainsi en compte la formation, la dotation des structures en outils et équipements modernes, l’accès à ces outils ainsi que leur utilisation.
Il a enfin félicité les organisateurs de cet important événement notamment le CILSS à travers le Centre Régional AGRHYMET, tout en saluant l’engagement soutenu et le leadership de la République du Niger avec le profond attachement de ses plus hautes autorités aux instruments de la coopération régionale en lien aux défis et enjeux de la résilience des communautés sahéliennes et leurs moyens d’existence face aux chocs climatiques et autres défis subséquents.

TROISIEME CONFERENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU SAHEL (CICC2024)
******
ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR ISSIFI BOUREIMA, SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CCRS
Monsieur le Ministre Coordonnateur du CILSS, Ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole du Tchad,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage,
Messieurs les Membres du Gouvernement du Niger,
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS,
Monsieur le Gouverneur de la Région de Niamey,
Monsieur le Directeur Général du CRA
Distingués invités à vos titre et grades,
Chers experts, chercheurs et partenaires de développement,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais à l’entame de mon propos saluer et féliciter l’initiative de l’organisation de la Troisième Conférence Scientifique Internationale sur le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest et au Sahel (CICC2024) en présentant par ailleurs, mes vifs remerciements au Centre Régional Agrhymet pour l’invitation qui m’a été adressée à m’exprimer au cours de la présente cérémonie.
Qu’il me soit aussi permis de saluer l’engagement soutenu et le leadership de la République du Niger, pour le profond attachement de ses plus hautes autorités aux instruments de la coopération régionale intéressant les défis et enjeux de la résilience des communautés et leurs moyens d’existence face aux chocs climatiques et autres subséquents. Le fait que la capitale du Niger, Niamey, soit la ville siège du Centre Régional Agrhymet à l’instar de certaines organisations interétatiques notamment, la Commission Climat pour la Région du Sahel en abritant aussi opportunément le présent évènement est illustratif de cet engagement susmentionné.
Mesdames, Messieurs
La Commission Climat pour la Région du Sahel, faudrait-il le souligner est une partie prenante importante du processus ayant conduit à la création de cet événement scientifique périodique, dont l’édition de cette année se tient dans un contexte aussi bien préoccupant que grave au regard de la tournure dramatique engendrée par les pics de chaleur enregistrés cette année au Sahel ainsi que les fortes précipitations qui s’y abattent ces dernières semaines au Niger comme dans le reste de la région.
Le thème de cette conférence choisi pour cette année : « Événements climatiques extrêmes et risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest et au Sahel », est ainsi opportunément à saluer en résonnant particulièrement dans nos réalités actuelles.
En effet, depuis plusieurs décennies nous sommes témoins au Sahel, parfois impuissants, de la fréquence accrue des épisodes de sécheresses, des inondations, de vagues de chaleur, et autres phénomènes météorologiques extrêmes, qui affectent nos populations et de leurs moyens de subsistance.
C’est le cas notamment de cette année 2024, où entre fin mars et début avril, plusieurs pays de la région du Sahel ont connu des chaleurs extrêmes avec des températures maximales de plus de 45 °C. Au Mali par exemple, la ville de Kayes a même enregistré un record de température de 48,5 °C le 3 avril 2024. A cet égard, il est important de souligner que selon une étude publiée le 18 avril par les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA), ces épisodes de vagues de chaleur exceptionnelle, autant par leur durée que par leur intensité, qui sévissent au Sahel est liée au changement climatique « d’origine humaine ».
Cette étude révèle ainsi, que les observations scientifiques et les comparaisons des modèles de températures « montrent que les vagues de chaleur de la magnitude observée en mars et avril 2024 dans la région auraient été impossibles » sans un réchauffement global de 1,2 °C « d’origine humaine ». Aussi, elle précise qu’un épisode comme celui qui a touché le Sahel pendant les premiers jours d’avril 2024 ne survient en principe qu’« une fois tous les deux cents ans ».
Par ailleurs, comme disait un adage, un malheur ne vient jamais seul, l’année 2024 s’est caractérisée aussi au Sahel par des précipitations exceptionnelles avec des conséquences énormes sur les populations, leurs moyens de subsistance et leur mobilité. Selon une récente publication d’Agrhymet, de fin juillet à la deuxième décade d’août 2024, les quantités de précipitations enregistrées dans la bande sahélienne (Tchad, Niger, Mali, Mauritanie et Nord Burkina Faso) étaient globalement supérieures, de 120 % à 600 % à la moyenne de la période de référence 1991-2020. Plus particulièrement, les quantités des pluies dépassaient la moyenne de 400 % à 600 % dans le Centre-Nord du Tchad et le Nord-Est du Niger. En conséquence, les cours d’eau et les fleuves sahéliens ont connu partout une montée très rapide des eaux. Dans les zones désertiques et semi-arides où les cours d’eau et les vallées ne coulent pas en permanence, des montées des eaux fulgurantes ont surpris les riverains et causé beaucoup de dégâts, comme dans le Tibesti tchadien.
Cette tendance s’est malheureusement maintenue au cours de la campagne en cours avec acquitté engendrant d’énormes dégâts humains et matériels dans plusieurs pays notamment au Niger où le dernier bilan diffusé a relevé plus de 278 pertes en vies humaines, 710 768 sinistrés et plus de 152 habitations effondrées sans compter l’étendue des champs de cultures engloutis et autres infrastructures détériorées. Cette situation à l’image d’une hécatombe naturelle est d’autant plus préoccupante lorsqu’ on se réfère aux projections scientifiques qui révèlent la persistance la tendance si des réponses appropriées ne sont pas prises face au changement climatique entropique.
En effet depuis quatre ans, l’Organisation Mondiale de la Météorologie publie annuellement son état des lieux sur le climat en Afrique. La toute dernière publication de cette année soutient évidemment que l’heure est d’autant plus grave dans le sens que le continent africain est confronté au risque de son effondrement climatique et économique. Il a été ainsi soutenu que l’Afrique se réchauffe de 0,3°C chaque décennie plus que la moyenne mondiale et que le niveau de la mer augmente de 3,4 à 4,1mm en comparaison à la moyenne mondiale. L’OMM estime ainsi que les conséquences à tous ces phénomènes entrainent une perte de 2 à 3 % du PIB des pays africains et certains utilisent 9 % de leur PIB pour celles-ci.
Mesdames Messieurs
Notre continent n’a pas d’autre choix que de s’adapter durablement à ces phénomènes météorologiques dont le coût des réponses est de l’ordre de 30 à 50 milliards par an. Faudrait-il ainsi relever que si les mesures requises ne sont pas prises la situation deviendra malheureusement irréparable dès 2030 pour 118 millions de personnes en raison des chaleurs extrêmes, les sècheresses et les inondations.
Il est ainsi fort à craindre que ces événements extrêmes ci-dessus cités ne soient plus des exceptions pour devenir la norme avec comme conséquences l’intensification des risques de catastrophes, menaçant non seulement l’effort de déploiement des actions de développement mais aussi la sécurité collective dans la région du Sahel. Cette crise climatique, osons le dire, que nous vivons aujourd’hui est un défi global, mais ses répercussions sont particulièrement sévères dans notre région, en raison notamment de sa vulnérabilité économique, environnementale et sociale.
Cependant, nous ne sommes pas condamnés à être de simples spectateurs passifs de cette tragédie. Il existe en effet des solutions qui résident dans notre capacité à anticiper, à innover, à coopérer et à agir ensemble.
Ainsi, une meilleure connaissance de ces phénomènes est hautement cruciale dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Nous avons besoin de mieux comprendre les dynamiques climatiques et d’envisager des réponses adaptées et durables. C’est pourquoi cette conférence est de notre humble avis d’une importance capitale pour la région du Sahel en réunissant, d’éminents experts et chercheurs ainsi que des partenaires techniques et financiers, pour partager leurs connaissances, leurs découvertes et leurs meilleures pratiques. La promotion d’une approche concertée, mobilisant toutes les forces vives est par ailleurs plus qu’opportune.
C’est dans cette dynamique que la Commission Climat pour la Région du Sahel, à travers le Plan d’Investissement Climat pour la Région du Sahel (PIC-RS) promeut la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités institutionnelles et techniques notamment, des institutions de recherches & développement, des organisations de la société civile et des acteurs locaux. Ce volet du PIC-RS prend ainsi en compte la formation, la dotation des structures en outils et équipements modernes, l’accès à ces outils ainsi que leur utilisation. Il prend également en compte l’appropriation des outils et méthodes par les acteurs.
Par ailleurs, l’occurrence des évènements climatiques extrêmes nécessite de disposer d’institutions de recherches, d’observations et de collecte de données et informations afin que leurs analyses et interprétations par des compétences nationales et régionales puissent éclairer les différents acteurs et les populations sur les prises de décision. Les systèmes d’information, les bases de données ainsi que les systèmes d’alerte doivent être développés pour faciliter les prises de décisions sur les mesures d’adaptation dans les différents domaines d’activités socioéconomiques.
Les initiatives de la CCRS, qu’elles soient à l’échelle locale ou régionale, visent ainsi à intégrer la dimension climatique dans toutes les politiques de développement. Aussi, conformément à son mandat la CCRS porte le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de l’adoption et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation robustes, du renforcement des systèmes d’alerte précoce et la promotion des investissements dans des infrastructures résilientes.
La CCRS se réjouit d’ores et déjà la mise en œuvre de certaines actions soutenues avec l’appui de ses partenaires dans le cadre du soutien de ses pays membres au renforcement de leur résilience et leur capacité d’adaptation. La CCRS se félicite également de l’excellente collaboration dont elle jouit avec les organisations sous régionales œuvrant dans le domaine notamment, le CILSS avec qui une convention de partenariat est prévue être signée demain mardi entre les deux exécutifs dans le cadre la mise en œuvre du Projet P2-P2RS qui vise opportunément à renforcer la sécurité alimentaire de 9 pays dont le Niger.
Mesdames Messieurs,
Il nous parait toutefois important de souligner l’ampleur du défi nous recommande qu’au-delà des réponses susmentionnées à promouvoir, un véritable changement de paradigme impulsant désormais des politiques publiques plus cohérentes et durables. Nous devons ainsi nous orienter vers des modes de vies qui restent en phase avec un développement socioéconomique plus résilient qui mettra en harmonie l’amélioration des conditions de vie de nos de populations avec le respect de l’environnement. Dans cette dynamique, il est important de renouveler notre appel envers la communauté climatique la nécessité que le principe de réparation soit enfin acquis afin que nos pays qui n’ont pas été responsable du changement climatique anthropique soient soutenus dans leurs efforts. Qu’il nous soit permis ainsi de rappeler que cela ne révèle pas d’une demande de charité mais plutôt de réparation de la justice climatique.
C’est dans cette dynamique que je saisis la présente occasion pour renouveler notre appel relatif au soutien au plaidoyer que nous portons à l’échelle internationale à la faveur d’un Deal international pour la promotion d’un nouveau pacte décennal pour un appui soutenu permettant de gagner irréversiblement le pari de la résilience, de l’adaptation et de la pacification de la région Sahel.
Toutefois, il est important de relever que pour mieux appuyer cette position nous nous devons de renforcer nos propres instruments de connaissances scientifiques qui nous permettront objectivement de mieux apprécier nos défis et d’appréhender les réponses appropriées.
Mesdames et Messieurs,
C’est dans cette perspective que je fonde l’espoir qu’à la faveur de cette troisième édition de cette conférence scientifique, que les conditions du pari de la mise en en place du GIEC Sahel soient enfin réunies. En effet le Sahel a besoin pour mieux porter sa voix face aux défis climatiques, d’avoir un cadre et une plateforme de scientifiques qui soient cohérents et dynamiques permettant de mieux suivre et anticiper les conséquences et les réponses appropriées. Cela est d’autant plus pertinent dans le sens que la disposition des données fiables sur l’état du climat est aussi bien importante pour nos pays tant dans le cadre de l’impulsion des politiques publiques adaptées, la formulation des projets bancables que pour la définition des éléments de langages cohérents pour le plaidoyer relatif à la mobilisation des ressources.
Je reste ainsi convaincu qu’en s’appuyant sur l’engagement de nos pays, la présence d’éminents experts et chercheurs scientifiques permettra des échanges fructueux qui aboutiront aux résultats attendus de cette conférence.
Je vous remercie de votre attention.